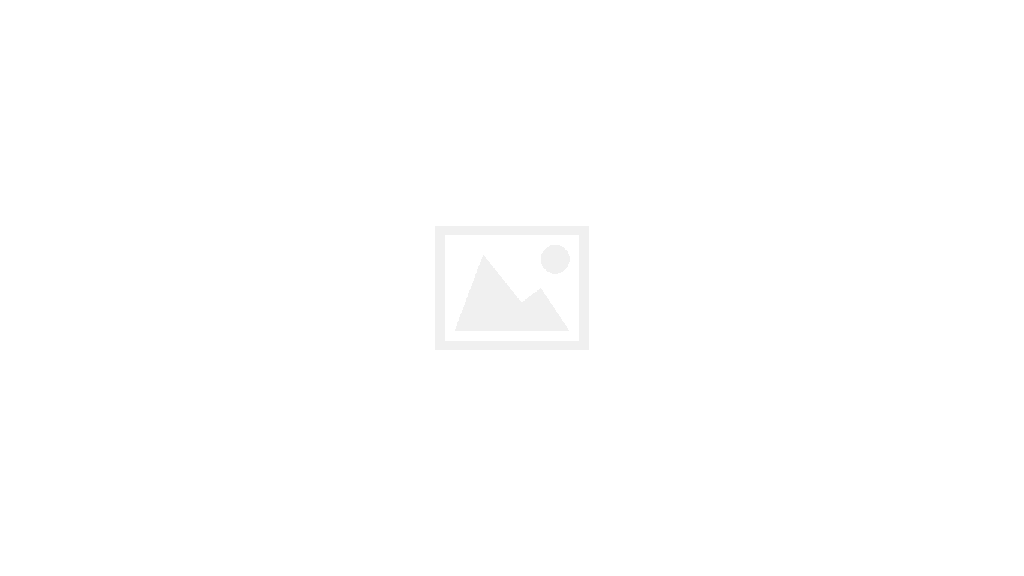Il y a vingt ans, dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, l’explosion au-dessus de Kigali de l’avion dans lequel voyageaient les présidents du Rwanda et du Burundi donnait le signal du déclenchement d’un génocide.
Pour la majorité de la presse internationale, cet événement fut une « surprise », comme peut l’être l’éruption soudaine d’un volcan. Et après le départ des expatriés, le génocide fut négligé, comme si l’assassinat de près d’un million d’êtres humains n’avait pas vraiment d’importance, dès lors qu’il se déroulait dans un pays « inutile » du bout du monde, de surcroît dans un pays dangereux dominé par des hordes d’assassins déterminés à « faire le travail » à huis clos.
Entre avril et juin, « il n’y eut jamais plus de 10 à 15 journalistes internationaux présents au Rwanda », écrit Lyndsey Hilsum, la célèbre journaliste de la chaîne britannique Channel Four. Il n’y eut qu’une seule vidéo montrant l’exécution du crime : celle d’un barrage hutu filmée le 18 avril par Nick Hughes, de la BBC.
Le photographe chilien Alfredo Jaar a dramatiquement illustré ce forfait médiatique dans une exposition qui met en scène l’hebdomadaire américain Newsweek. Pendant 16 semaines, ce magazine, qui était alors un des fleurons du journalisme international, ne publia en « une » aucune information sur le génocide. Au fil des semaines, en dépit de l’augmentation hallucinante du nombre de victimes, ses covers ne présentèrent que des sujets de société et des portraits de célébrités. La première référence au Rwanda intervint le 1er août, lorsque le génocide avait pris fin et que des centaines de milliers de Hutus fuyaient vers le Zaïre.
Si des journalistes belges tentèrent de savoir et de dire, la presse internationale parla peu du génocide, mais de surcroît, elle en parla mal, dans la mesure où pendant des semaines, elle s’obstina le plus souvent à disserter sur des « haines venues du fond des âges ». Alors qu’il s’agissait d’une entreprise systématique, étatique, de mise à mort de la communauté tutsi et de ceux qui voulaient la protéger.
Le constat d’Allan Thompson, coordinateur du livre The Media and the Rwanda Genocide, est cruel : « En raison de leur absence et de leur incapacité à observer et à enregistrer adéquatement les événements, les journalistes favorisèrent le comportement des exécutants du génocide, qui furent encouragés par l’apathie du monde et agirent en toute impunité ».
Les lanceurs d’alerte
La faillite de la presse précéda le génocide, car le processus d’extermination ne commença pas le 7 avril 1994. Il était inscrit dans une large mesure dans l’idéologie qui prévalait depuis des décennies au Rwanda, un pays discret, fréquenté par de rares journalistes, dont les plus crédules ou les plus complaisants se laissèrent charmer par la propagande officielle sur cette Arcadie chrétienne ancrée au cœur du continent africain.
Au début des années 90, quelques journalistes belges, comme Colette Braeckman du Soir, osèrent briser cette image et ils furent très vite accusés d’alarmisme, voire de partialité. Presque personne ne voulut entendre que des exterminationnistes attisaient la haine, établissaient des listes de personnes à rafler et à éliminer, achetaient des centaines de milliers de machettes et formaient des milices.
Depuis ces années 90, le journalisme international a revisité l’histoire de sa narration des atrocités de masse. Une histoire émaillée de ratages, d’indifférences, voire d’infamies. Le 3 novembre 1896, lors des massacres arméniens perpétrés par le Sultan rouge d’un Empire ottoman finissant, Jean Jaurès s’était indigné de « ce silence de la presse, dont une partie, ajoutait-il, je le sais, a été payée pour se taire ».
Le même silence a entouré l’Holocauste. « La presse aurait dû crier plus fort », écrit Marvin Kalb de l’université de Harvard. Les « crieurs », comme les appela Arthur Koestler, furent une minorité, en effet. A l’exemple d’Edgar Mowrer, correspondant à Berlin du Chicago Daily News, qui, dès 1933, s’insurgea contre la « campagne barbare menée contre les Juifs » et parla même « d’extermination » en évoquant « le pire à venir ». A l’exemple de Varian Fry qui, en décembre 1942, écrivit dans The New Republic un article au titre sans équivoque, Le Massacre des Juifs. « Les lettres, les rapports, les télex dessinent les contours du massacre de masse le plus terrifiant de l’histoire de l’humanité », s’indigna-t-il. A l’instar d’Izzy Stone qui, le même mois, dans The Nation dénonça « l’assassinat d’un peuple », « un cauchemar si terrifiant que le monde en frissonnera d’horreur pendant les siècles à venir ».
Une poignée de “crieurs”
La leçon n’a pas vraiment été entendue lors des atrocités qui ensanglantèrent l’histoire tourmentée de l’après-guerre. Qui dénonça les massacres et la torture lors de la guerre d’indépendance d’Algérie ? Une demi-douzaine de journaux, comme Le Monde, L’Express, France-Observateur ou Témoignage Chrétien, un quarteron de journalistes et d’intellectuels comme François Mauriac, Pierre Vidal-Naquet et Claude Bourdet.
Qui informa sur les massacres perpétrés par les troupes indonésiennes après leur occupation de Timor oriental en 1975 ? Quelques journalistes très vite qualifiés –disqualifiés – de « militants », John Pilger, Amy Goodman et Allan Nairn.
Qui, au Cambodge, avertit tout de suite que les Khmers rouges étaient des massacreurs et non des libérateurs, à part Sydney Schanberg du New York Times et François Ponchaud de La Croix ?
Les mêmes interrogations resurgissent aujourd’hui sur l’absence de la presse internationale en République centrafricaine, alors que sévit l’épuration religieuse et que le spectre du génocide menace. Et une phrase nous revient, prononcée en 2004 lors d’un autre ratage, celui de la crise du Darfour, alors que l’on commémorait le dixième anniversaire du génocide rwandais. « Les médias ne couvrent pas les génocides, s’exclama Carroll Bogert, directrice adjointe de Human Rights Watch. Ils couvrent les anniversaires de génocides ».
La commémoration du génocide rwandais n’aurait pas de sens, elle serait même indécente, si la communauté internationale se limitait à contempler le passé et à battre sa coulpe. Et dans cette confrontation avec l’Histoire et sa propre histoire, la presse doit s’interroger non seulement sur ses modes de fonctionnement, mais aussi sur les principes les plus essentiels qui l’animent.
Pourquoi une poignée de journalistes américains sonnèrent-ils le tocsin à propos de l’Holocauste, alors que la majorité de leurs collègues, qui disposaient des mêmes informations, se taisaient ?, s’interrogeait Deborah Lipstadt dans son remarquable essai Beyond Belief. Parce qu’ils rejetaient l’idée que l’extermination des Juifs était inévitable, répondait-elle. Parce qu’ils refusaient que la barbarie l’emporte sur la dignité humaine.
En fait, leur humanisme, leur indignation, leur « irréalisme », leur dissidence et leur engagement en firent de bien meilleurs journalistes que les tenants de l’école de l’objectivité, du réalisme et de la froideur. Ils furent les seuls à sortir la tête haute de cette déroute généralisée du journalisme face au « crime des crimes ». Parce qu’ils croyaient à une éthique existentielle de l’information. Parce que le devoir d’informer était pour eux un devoir d’humanité, fût-il désespéré.
Note: Ce texte s’inspire d’un discours prononcé au Palais d’Egmont le 2 avril, à l’occasion de la conférence sur la Prévention du génocide, organisée par le ministère belge des Affaires étrangères, sous la coordination de l’ambassadeur Jean-Marie Deboutte et en présence du secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, de Serge Brammertz, etc.